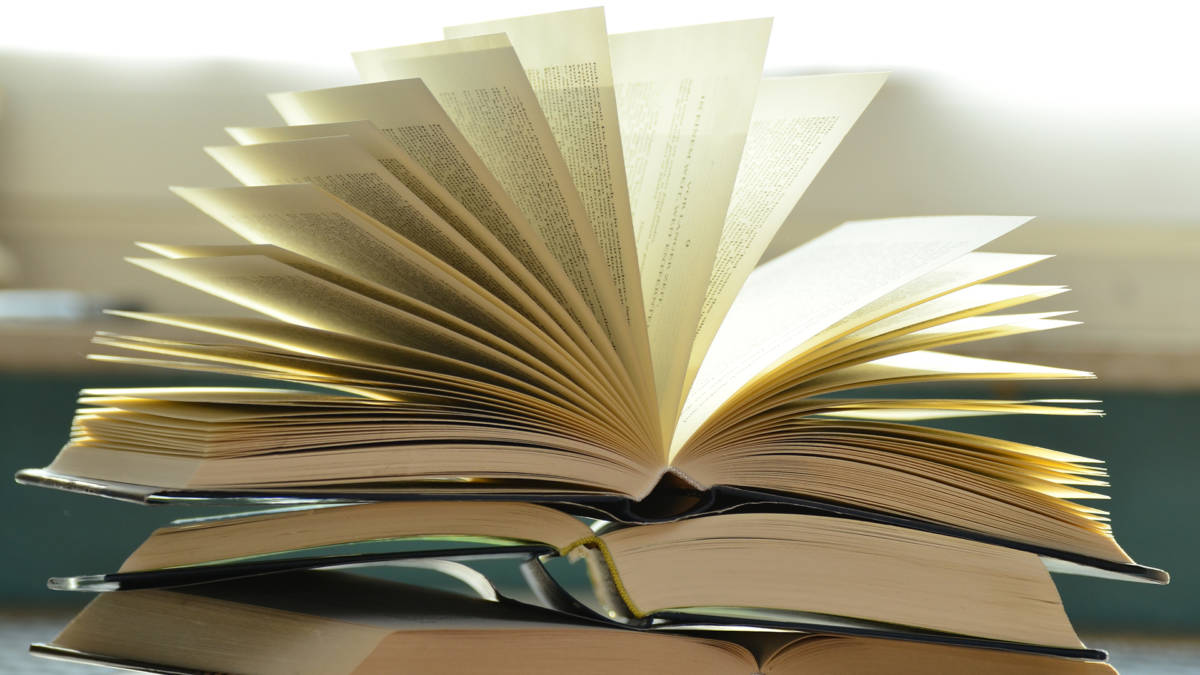#hopitaldufutur : Martin Winckler, quels enseignements tirer de la comparaison entre les hôpitaux en France et au Québec ?
Martin Winckler : Il y a deux grandes différences entre le système de santé en France et au Québec (parce que c’est surtout au Québec que je le connais). La première, au Canada, la santé est de compétence provinciale, il y a dix provinces et deux territoires. Chaque province décide elle-même de sa politique de santé, ce n’est pas le gouvernement fédéral à Ottawa qui décide pour elle, elles leur attribuent un certain nombre de chose, de subside, d’aide pour que chaque province décide de sa santé, mais chaque province est autonome. A tel point que, par exemple, il y a 7 ou 8 ans, quand il y a eu un grand débat sur l’assistance médicale à mourir, le Québec avait décidé de voter pour qu’elle soit autorisée, et quand on leur faisait remarquer que le code criminel pouvait se retourner contre les médecins québécois qui pratiquent l’assistance médicale à mourir, le Québec avait dit, « comme la santé est une compétence provinciale, le gouvernement du Québec demandera au procureur de ne pas poursuivre les médecins qui accompagneront les personnes qui demandent à mourir ». Donc vous voyez qu’il y a une autonomie qui est extrêmement grande, et qui va même jusqu’au judiciaire dans certains cas. C’est la première chose, c’est d’abord l’autonomie des régions, et c’est ce qui m’a inspiré aussi quand j’ai écrit « l’Ecole des soignantes ». Je me suis bien rendu compte que je ne pouvais pas juste décrire un hôpital utopique, il fallait que ce soit un projet politique qui avait été suscité par la communauté urbaine de Tourmens, c’est-à-dire des gens qui étaient aux commandes d’une ville qui était assez importante, avec une périphérie assez importante, et que ce projet était leur projet. Je suis parti de l’idée que, pour des raisons que je n’explique pas, leur autonomie sanitaire était extrêmement grande, et que donc ils pouvaient décider de faire un hôpital comme ils en avaient envie, et non pas comme le ministère de la santé en France le décidait. Il n’est possible de construire des structures que quand l’autonomie politique locale ou régionale est grande. La deuxième différence touche cette fois les personnes, et là je vais vous parler spécifiquement du Québec. Le Québec a une attitude extrêmement tournée vers les soignés et aussi une attitude très peu hiérarchisée. En 2004 ou 2005, je ne sais plus, j’ai été invité par l’Association Internationale des Infirmières Francophones dont le congrès se passait à Montréal à ce moment-là. Deux ans à l’avance, la présidente de l’association internationale des infirmières francophone vient en France et demande à me voir. On va donc manger ensemble, et elle me raconte cette histoire, qui lui parait insensée, c’est qu’elle est allée, avec ses collègues cadres infirmiers au CHUM (Centre Hospitalier Universitaire de Montréal), faire une séance de travail avec ses collègues de l’AP-HP, et elle leur dit : nous au CHUM, les soins sont entièrement organisés par les cadres infirmiers, c’est-à-dire que les cadres infirmiers décident des horaires des blocs opératoires, des consultations, des soins, comment on les organise etc. Et ses collègues lui disaient, « Et les médecins alors ? », et elle répond, « Eh bien les médecins, ils se mettent dans les cases. Si on leur dit, il a un bloc qui est ouvert de telle heure à telle heure pour opérer des cataractes, les médecins qui opèrent des cataractes vont aller au bloc à ces heures-là. Ils peuvent échanger entre eux bien entendu, mais ils ne peuvent pas changer les heures de blocs. » Alors ses collègues de l’AP-HP disent, « Nous, on essaye d’organiser autour de ce que les médecins demandent, ou exigent, ou imposent. » De fait, moi, j’ai pu tester comme patient l’efficacité de l’organisation d’un service extrêmement fréquenté, celui d’ophtalmologie, car j’ai été opéré de la cataracte assez jeune. On m’a dit, « Vous savez, d’ici 3 / 4 ans, vous ne pourrez plus conduire, donc il va falloir vous faire opérer. » Je vais à l’hôpital Notre-Dame, je rentre et j’arrive dans une salle dans laquelle il y a 250 personnes assises. Je me dis que j’en ai pour un moment… On me dit, « Prenez un numéro », je dis « Mais j’ai rendez-vous… », on me répond, « Non, non, prenez un numéro » … Je prends mon numéro, le 79., et je vais m’assoir. Et j’entends « le numéro 74 ». En fait, il y avait toutes les salles d’attente en même temps, de tout l’étage, tout le monde était dans la même salle d’attente, ce qui fait qu’on avait l’impression d’être très nombreux, mais en fait on était dispatché sur plusieurs lieux de consultations de soins etc., donc on n’attendait pas tant que ça. J’ai dû attendre 8 min avant qu’on m’appelle pour prendre mon nom, ma carte de sécurité sociale, et me dire d’aller dans le couloir à gauche et de m’assoir sur la chaise vide et puis au fur et à mesure que les chaises se vident à votre gauche, vous allez vous déplacer. Je m’assieds et au moment où je m’assieds la personne qui est au bout se lève tout de suite et va faire ses tests. Là on me faisait faire des tests visuels, pour savoir quel était mon champ de vision etc. Et à chaque fois, à chaque étape, c’était comme ça, c’est-à-dire qu’on me faisait mon test puis on me faisait assoir sur un autre endroit. Et puis, à cette endroit-là, on me dit, « Là, on va venir vous chercher dans quelques minutes », et on venait me chercher. Le tout, y compris avec la consultation avec le médecin qui a duré peut-être 20 min quand même, parce qu’elle avait tous les éléments en main comme on m’a fait tous les tests. Elle m’a posé des questions, si je voulais me faire opérer, quel type de lentilles je voulais qu’on me pose, si j’avais peur, etc… Elle m’a expliqué comment elle allait faire, tout ça en 20 min. Au bout d’une heure, j’étais dehors. Et quand je suis allé me faire opérer, même chose, c’est-à-dire je suis rentré, la première fois à 7h30 du matin, pour être opérer à 11h, la deuxième fois, j’ai dû rentrer à 10h pour être opérer à midi. Et dans la salle de réveil, qui n’en était pas une parce qu’on n’était pas endormis, on était 6 ou 8 personnes assises, tout le monde était assis dans des fauteuils qui pouvaient s’incliner, on pouvait s’allonger dessus. A une ou deux reprises il y avait des gens qui avaient des besoins particuliers, ensuite il y a eu une infirmière ou un infirmier qui est venu. Au bout de 3h, j’étais sorti, et tout ça, est facilité par le fait que la hiérarchie est limitée au maximum, c’est-à-dire que chaque personne joue son rôle. Pour vous donner une dernière anecdote, la deuxième fois que j’ai été opéré, quelqu’un est venu me chercher, on m’a demandé de monter sur un brancard, j’ai été opéré sur le brancard médicalisé, c’est-à-dire on ne m’a pas fait passer d’un brancard à un autre. On m’a mis sous le scialytique, et on m’a opéré comme ça. Après, quand l’intervention a été terminée, la personne qui m’avait accompagné, n’était pas là, et c’est le médecin anesthésiste qui a poussé mon brancard jusqu’à la salle de soins, de façon tout à fait naturelle, en discutant avec moi, on me demandait si ça va, si je connais les instructions etc. très gentiment, comme l’aurait fait l’infirmière si ça avait été l’infirmière. C’est-à-dire que la répartition des rôles n’était pas dictée par le statut, elle était dictée par le moment et le besoin de la personne à soigner à ce moment-là. Pour moi, un lieu de soins, c’est ça : c’est un lieu où l’on soigne, ce n’est pas un lieu où l’on fait en sorte que les gens passent le moins de temps possible parce que ça coute cher de les garder. Et je reviens à ce que je disais tout à l‘heure, c’était d’une efficacité extraordinaire, mais pas du tout au détriment de la qualité des soins qu’on m’a délivré. Je veux dire, ils opèrent 30.000 cataractes par an à Notre-Dame, ce n’est pas un petit centre, c’est le grand centre d’intervention ophtalmologique de Montréal. C’est hyper bien organisé, mais jamais au détriment des personnes dont on s’occupe. Je crois que si on veut changer les hôpitaux en France, il faut garder ça à l’esprit, garder ça comme modèle. Evidemment, il faut l’adapter aux caractéristiques du pays, mais fondamentalement, c’est la différence entre une décision centralisée et éloignée, fondée sur des repères théoriques, et puis des décisions localisées sur le terrain, fondées sur des critères pragmatiques et conséquentialistes, c’est-à-dire que c’est le résultat qui compte. Et ça rejoint ma perception, qui est qu’on peut dire que les gens ont été soignés que si les gens vous disent, « j’ai été soigné ». Ce ne sont pas les professionnels de santé qui disent, « on les a soignés ». Vous leur avez délivré des soins, mais est-ce qu’ils ont été soignés, ça, c’est à eux de le dire. Vous savez aussi que, par exemple, en Amérique du Nord ou en Angleterre, les questionnaires de satisfaction sont quasiment systématiques partout, c’est-à-dire ce n’est pas seulement un questionnaire à l’entrée, c’est aussi à la sortie, 3 dites-nous ce qu’il va, ce qu’il ne va pas, ce qu’on pourrait changer, racontez-nous les incidents ». Et puis c’est traité, ça ne va pas dans une boite qui est oubliée, il y a des gens qui ne font que ça, qui ne s’occupent que des contrôles de qualité dans les hôpitaux. Dans les structures publiques, je ne vous parle pas du privé là. C’est ce dont je me suis aussi inspiré pour écrire « L’Ecole des soignantes ». Je me suis à la fois inspiré d’expériences personnelles, c’est-à-dire que j’ai été brancardier, aide-soignant, j’ai fait des remplacements d’infirmier, j’ai été externe, j’ai fait des remplacements d’interne, après je ne suis pas monté plus haut dans la hiérarchie parce que ça ne m’intéressait pas, je voulais faire de la médecine générale, mais j’ai fait tous les petits métiers, progressivement, au fur-et-à-mesure de mes études. Inévitablement, je suis allé faire un stage en pharmacie, j’y suis allé une journée, eh bien je n’ai plus vu une pharmacie de la même manière, rien qu’en un jour, je ne sais pas ce que j’aurais pu apprendre si j’avais passé 15 jours là-bas. L’un des fléaux du système de santé français, c’est la fragmentation hiérarchique et aussi pragmatique des professionnels. On ne peut pas savoir ce qu’est le problème des infirmières, si on n’a pas bossé avec des infirmières, ou en tant qu’infirmière par exemple.
C’est ce qui m’a inspiré aussi quand j’ai écrit « l’Ecole des soignantes ». Je me suis bien rendu compte que je ne pouvais pas juste décrire un hôpital utopique, il fallait que ce soit un projet politique qui avait été suscité par la communauté urbaine de Tourmens, c’est-à-dire des gens qui étaient aux commandes d’une ville qui était assez importante, avec une périphérie assez importante, et que ce projet était leur projet
#hopitaldufutur : Dans « L’Ecole des Soignantes », les soigné.e.s deviennent des partenaires : est-ce une réalité au Canada ?
Martin Winckler : C’est parce que précisément la hiérarchie est beaucoup moins importante dans un pays comme le Canada, que la question du patient partenaire est apparue beaucoup plus tôt qu’en France. Parce qu’en même temps on dit, « Qui connait mieux le diabète qu’une personne diabétique ? ». Je peux avoir des tas de connaissances théoriques sur le diabète, mais pas la quotidienneté du vécu du diabète. J’ai commencé il y a 20 ans à venir au Canada, donc 10 ans avant d’y immigrer. La première chose qu’on apprenait aux diabétologues, c’était d’aller passer du temps dans une association de diabétiques, d’aller écouter comment ils vivent, juste écouter, vous n’allez pas leur dire comment il faut qu’ils fassent. Parce que la réalité de leur maladie, c’est ça, vous ne pouvez pas prescrire si vous ne connaissez pas la réalité, sociale, culturelle, pratique… On ne peut pas trop trouver du matériel pour faire des dextros par exemple, parce que tel labo n’en fait plus. Vous ne pouvez pas comprendre la réalité du diabète si vous ne savez pas comment les malades vivent. J’ai entendu ça il y a 20 ans dans les écoles de médecine du Québec, et d’ailleurs au Canada, parce que je suis allé dans beaucoup d’endroits au Canada. Ça tombe sous le sens, mais ça ne peut tomber sous les sens qu’à partir du moment où l’on conçoit que le soin, c’est une activité collective, et que ce n’est pas une activité de compétition. Et la hiérarchisation du système de santé s’oppose à ça, parce qu’il y a de la hiérarchie, il y a de la compétition, puisque tout le monde veut monter. Et évidemment, ce qui est en bas de la hiérarchie, c’est le patient, c’est la personne soignée. Ici la santé est un enjeu communautaire, c’est le mot qui est utilisé. Qui c’est la communauté ? C’est tout le monde, il n’y a rien de plus gratifiant que de dire je participe à un projet communautaire, avec mes outils, avec ma compétence, avec mon expertise, avec mon savoir, avec mon énergie si je n’ai pas de compétences particulières. C’est ça l’obstacle que vous avez à affronter, ce n’est pas un obstacle pratique, c’est un obstacle idéologique. Je pense qu’on peut changer les mentalités quand on peut changer localement les pratiques. Dans l’immédiat, il faut changer les choses au niveau locale départemental, régional si c’est possible, et proposer d’autres expériences, parce que quand les expériences locales réussissent elles font des petits. Parce que ceux qui ont réussi leurs expériences locales, ils connaissent les problèmes juridiques, les problèmes architecturaux, les problèmes pratiques, peuvent dire à la région d’à côté, « Voilà comment on a résolu le problème ». Si ça vient d’en haut, ce n’est pas possible, ça ne marchera pas, parce qu’on voudra mettre tout le monde dans le même sac, et tout le monde ne va pas dans le même sac.
Vous ne pouvez pas comprendre la réalité du diabète si vous ne savez pas comment les malades vivent. J’ai entendu ça il y a 20 ans dans les écoles de médecine du Québec, et d’ailleurs au Canada, parce que je suis allé dans beaucoup d’endroits au Canada. Ça tombe sous le sens, mais ça ne peut tomber sous les sens qu’à partir du moment où l’on conçoit que le soin, c’est une activité collective, et que ce n’est pas une activité de compétition
#hopitaldufutur : L’espace est-il un outil pour soigner autrement ?
Martin Winckler : Quand je me suis installé dans mon cabinet médical, j’ai mis mon bureau dans un coin de la pièce. Mon bureau, c’est une table sur deux tréteaux, et puis je me suis assis là, les personnes qui venaient me voir était assises à ma droite. Donc, j’étais obligé de me tourner vers elles, et puis quand j’avais quelque chose à leur expliquer, je mettais un papier au coin de la table, comme ça quand on était tous les 3, quand ils venaient à deux, on regardait au même endroit. Je n’étais pas de l’autre côté, j’étais du même côté. Ça troublait un peu les gens au début, mais ça ne les a pas troublés longtemps, parce que les enfants pouvaient venir à côté de moi regarder ce que je faisais, et moi ça ne me gênait pas, j’avais des enfants. On était toujours à portée de main. Si je voulais prendre la main de quelqu’un, j’avais juste à allonger le bras et je pouvais prendre sa main. Evidemment ça change tout de faire des tables rondes, mais vraiment rondes. Je me souviens avoir parlé avec un interne, dans un grand service de cancérologie à Paris, il était en burn-out, il me disait, « Je n’en peut plus de faire des annonces de cancer grave dans le couloir ». Je lui dis, « Mais comment ça, dans le couloir ? » Et il me dit, « Bah oui, on n’a pas de bureau » « Mais comment ça, vous n’avez pas de bureau, l’assistant il a bien un bureau ? » Alors il me dit, « Oui, mais on n’a pas la clé, on ne peut pas rentrer, donc on est obligé de faire ça dans le couloir ». Ce sont des conditions de travail impossible, même pour les gens qui veulent travailler autrement, parce qu’il y en a qui ne veulent pas d’accord. Mais ceux qui veulent travailler autrement, ils ne peuvent pas. Repenser les choses, quand on a besoin d’avoir une conversation avec une famille, il y a un lieu qui soit une sorte de petit salon de réception où l’on peut recevoir une personne, ou deux, ou trois.
Quand je me suis installé dans mon cabinet médical, j’ai mis mon bureau dans un coin de la pièce. Mon bureau, c’est une table sur deux tréteaux, et puis je me suis assis là, les personnes qui venaient me voir était assises à ma droite. Donc, j’étais obligé de me tourner vers elles, et puis quand j’avais quelque chose à leur expliquer, je mettais un papier au coin de la table, comme ça quand on était tous les 3, quand ils venaient à deux, on regardait au même endroit. Je n’étais pas de l’autre côté, j’étais du même côté
#hopitaldufutur : Quelles seraient vos suggestions sur les espaces de l’hôpital ?
Martin Winckler : Je pense que décentraliser, c’est la première chose. Ensuite, faire un hôpital dans lequel le poste infirmier est au milieu du couloir dans lesquels on peut se perdre, je pense que c’est problématique. Avoir quelque chose qui est central, et qui regarde vers tous les couloirs, ou vers toute les zones de soins et qui soit ouvert et non pas enfermé, c’est déjà une manière de mieux voir. Ça veut dire aussi qu’il faut qu’il y ait plus de monde pour soigner, ça aussi c’est un problème qui ne dépend pas de l’architecture, c’est-à-dire que si vous avez trois infirmières pour un étage, même si leur étage est panoptique, si elles ont 60 patients elles ne vont pas pouvoir s’en occuper. Mais si vous avez plus de professionnels de santé qui sont regroupés ensemble et qui peuvent rayonner vers une zone qui est visible par tout le monde, ça veut dire que si une personne qui est affectée à tel secteur est prise à autre chose, une autre personne qui elle n’est pas occupée peut voir qu’il y a quelque chose qui se passe dans ce secteur-là, et y aller à sa place. Ce qu’elle ne peut pas faire si tout le monde est séparé et affecté uniquement à une zone. C’est la possibilité de déléguer. La santé, c’est communautaire quand on peut s’entraider.
Si une personne qui est affectée à tel secteur est prise à autre chose, une autre personne qui n’est pas occupée peut voir qu’il y a quelque chose qui se passe dans ce secteur-là, et y aller à sa place. Ce qu’elle ne peut pas faire si tout le monde est séparé et affecté uniquement à une zone. C’est la possibilité de déléguer. La santé, c’est communautaire quand on peut s’entraider
#hopitaldufutur : Comment imagineriez-vous la forme de cet hôpital communautaire ?
Martin Winckler : Pour la prison, Foucault a pensé aux panoptiques, c’est une bonne idée, adaptée à mon avis à l’hôpital. Voila l’hôpital tel que je l’imaginerais. Un hôpital, c’est toujours un cube, pourquoi faire un cube et pas un cercle ? C’est-à-dire quelque chose qui ait une forme circulaire. A l’intérieur de cette forme circulaire, vous avez ce que j’appelle une marguerite, c’est-à-dire des sous services qui sont répartis tout autour de la marguerite, et dans ces sous-services évidemment, il y a les chambres des personnes qui sont soignées. Entre les chambres, il y a un lieu où il y a des soignants. Et puis au centre de l’étage, vous avez un certain nombre de structures qui sont dévolues à l’ensemble de la marguerite. Par exemple, si vous avez besoin d’une salle de déchocage, d’un bloc opératoire, d’une salle de réunion, vous mettez ça au centre. L’avantage étant que tout le monde a la même distance pour y aller, on n’est pas obligé de marcher dans des couloirs. C’est-à-dire que, en ayant une structure qui est circulaire, au centre, on peut aussi mettre des bureaux administratifs, c’est à dire que les administratifs sont parmi les soignants, et quand on leur dit, « on a tel problème », ils ont 20 ou 30 mètres à faire pour aller voir, ils n’ont pas à traverser l’hôpital pendant l’hiver, etc… Je crois que véritablement, ça nécessite de concevoir le lieu de soin comme un lieu communautaire. Pensez à ces immenses maisons communautaires qu’il y en Chine, dans les régions les plus traditionnelles, où en fait les villes sont des sortes d’immenses maisons rondes dans lesquels les gens ont leur appartement autour, et au milieu vous avez un marché, un lieu de réunion, un lieu de fête. La structure de la communauté en tant que cercle, ou le village français avec son église au milieu et puis les maisons autour. Il faut concevoir comme un lieu où tout le monde passe par le centre, les ascenseurs sont au centre comme ça vous pouvez passer d’un bloc à un autre. Les gens ne se perdent pas à l’hôpital parce qu’ils arrivent dans un endroit où il y aura des directions. J’ai vu ça dans les hôpitaux américains, vous avez des flèches de couleur par terre, si vous voulez aller en chirurgie vous suivez le vert, si vous voulez aller en gynécologie obstétrique, vous suivez le rouge, ce n’est pas compliqué. Il y a des moyens de rendre l’hôpital non seulement accueillant, soignant, fonctionnel, mais aussi chaleureux. La forme ronde est une forme où tout le monde est à égal distance de tout le monde. Pensez aux hôpitaux où on réserve toujours la chambre qui est au bout du couloir, celle où on met les gens qu’on ne veut pas voir. C’est une iniquité, tout le monde devrait être soigné en fonction de ses besoins. Si vous faites une zone qui est circulaire, ça veut dire encore une fois que les professionnels de santé, ils sont à égal distance de tout le monde, ça donne une atmosphère particulière qui n’est pas celle dans laquelle vous avez des couloirs à gauche, des couloirs à droite, des couloirs tout droit, des portes où vous ne voyez pas qui est où. Il y a des choses à imaginer qui sont matériellement possibles, qui ne peuvent pas s’imaginer dans un hôpital qui ressemble à un cube.
C’est une iniquité, tout le monde devrait être soigné en fonction de ses besoins. Si vous faites une zone qui est circulaire, ça veut dire encore une fois que les professionnels de santé, ils sont à égal distance de tout le monde, ça donne une atmosphère particulière qui n’est pas celle dans laquelle vous avez des couloirs à gauche, des couloirs à droite, des couloirs tout droit, des portes où vous ne voyez pas qui est où. Il y a des choses à imaginer qui sont matériellement possibles, qui ne peuvent pas s’imaginer dans un hôpital qui ressemble à un cube
#hopitaldufutur : L’hôpital du futur sera métropolitain. Qu’en pensez-vous ?
Martin Winckler : L’hôpital est quand même un lieu de vie, il y a des gens qui y passent beaucoup de temps, on y a mis beaucoup de chose qui participent au lieu de vie, on y a mis des boutiques, il y a des lieux pour manger, il y a des écoles pour les enfants qui sont hospitalisé, il y a un lieu de prière, donc effectivement, pourquoi, au lieu d’amener la ville à l’intérieur de l’hôpital, on ne met pas l’hôpital à l’intérieur de la ville ? C’est-à-dire à un endroit où il est ouvert sur la ville. Historiquement, l’hôpital c’est l’endroit où on mettait les gens malades parce qu’ils étaient dangereux ou contagieux, mais on n’est plus dans cette perspective. On sait faire la différence entre quelqu’un qui est contagieux et quelqu’un qui ne l’ai pas. Moi je pense que mettre les hôpitaux à la périphérie pour des raisons budgétaires, ce n’est peut-être pas la bonne solution. Il faut peut-être penser à décentraliser les lieux de soins, qui sont des lieux de consultation, de suivi, de dépistage. La logique de l’hôpital décentralisé, c’est que tout le monde va voir les médecins. Ça m’est arrivé de rendre visite à des médecins de famille, dans lesquels il y a un bureau qui est dévolu au spécialiste qui vient voir les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Donc le cardiologue, il vient environ 3 fois par mois et les patients du cabinet médical, ils ne vont pas aller attendre dans la salle d’attente du CHUM, ils vont venir dans leur cabinet communautaire. Concevoir les soins non pas comme, « il y a l’hôpital d’un côté et les consultations de l’autre côté », faisons de tout ça un réseau, comme un réseau nerveux, avec des nodules un peu partout, avec des moyens de communication. Toute cette conception de l’hôpital centralisé, à mon avis, elle mérite d’être revue complétement. C’est-à-dire, il faut se demander ce qu’on n’a pas besoin d’avoir dans un lieu hospitalier. Fondamentalement, ce dont on a besoin dans une structure hospitalière, c’est tout ce qui permet de soigner des gens qui doivent y rester entre 24h et 3 mois, mais pour les autres, je ne pense pas qu’il faut qu’il y ait des consultations à l’hôpital, elles devraient être faite en lieu communautaire, à l’extérieur, là où les gens se trouvent. Alors évidemment, il y a des choses qui ne dépendent pas des concepteurs du lieu de soins, mais en tout cas on peut faire des propositions.
Toute cette conception de l’hôpital centralisé, à mon avis, elle mérite d’être revue complétement. C’est-à-dire, il faut se demander ce qu’on n’a pas besoin d’avoir dans un lieu hospitalier
#hopitaldufutur : Et quel sera le rapport de l’hôpital à l’environnement, à l’écologie ?
Martin Winckler : Mon hôpital en marguerite, il est évident qu’en bas des ascenseurs, il y a un jardin, et puis on essaye de mettre des arbres aussi autour, pour que les gens voient des arbres par leur fenêtre. Ce qui est important aussi, c’est comment on conçoit l’hôpital, par rapport à l’environnement, lieu par lieu. Il y a une autre dimension qui est la dimension de la consommation : l’hôpital est un lieu où on pollue beaucoup, à partir du moment où vous avez des produits chimiques, du matériel à usage unique, c’est inévitable. Ce qu’il faut repenser, c’est la façon dont on utilise tout ça, et la façon dont on gère les déchets, recyclables ou non recyclables. Tout ce qui doit être brulé peut être recyclé par exemple, et peut servir de combustible pour chauffer l’hôpital. Plus une structure est autonome, plus elle est communautaire.
Mon hôpital en marguerite, il est évident qu’en bas des ascenseurs, il y a un jardin, et puis on essaye de mettre des arbres aussi autour, pour que les gens voient des arbres par leur fenêtre
#hopitaldufutur : Dans « L’Ecole des Soignantes », vous évoquez la fin de vie. Est-ce aussi une question spatiale ?
Martin Winckler : J’ai fait la connaissance d’un médecin généraliste qui travaillait sur une des iles Scilly. Ils faisaient leur visite en bateau, quand ils allaient voir les gens sur les autres iles, quand ils voulaient faire hospitaliser quelqu’un, il y avait un hélicoptère qui les ramenait sur le territoire du Royaume-Uni. Mais dans leur cabinet médical communautaire, qui est sur la plus grande ile, ils ont deux ou trois chambres, dans lesquelles ils peuvent admettre des patients qui ont besoin de soin rapprochés pendant deux trois jours, et ils ont une chambre de fin de vie. La question de l’euthanasie est moins un problème chez eux. Lorsque qu’une personne est en fin de vie et qu’elle n’a pas envie de mourir chez elle, ils ont un appartement de fin de vie avec tout ce qu’il faut, qui est médicalisé, avec une grande baie vitrée qui donne sur la mer. C’est un lieu de soin communautaire, dans un endroit où vous ne pouvez pas avoir d’hôpital. Le problème de la fragmentation à l’intérieur de l’hôpital, c’est que ça sous-utilise les capacités des professionnels. Alors que si vous les mettez dans des lieux où c’est important qu’ils utilisent toutes leurs capacités pour que justement la personne soignée ne soit pas obligée d’aller à150km pour se faire hospitaliser, ça change complètement les données.
Le problème de la fragmentation à l’intérieur de l’hôpital, c’est que ça sous-utilise les capacités des professionnels. Alors que si vous les mettez dans des lieux où c’est important qu’ils utilisent toutes leurs capacités pour que justement la personne soignée ne soit pas obligée d’aller à 150 km pour se faire hospitaliser, ça change complètement les données
#hopitaldufutur : Le respect de la décision du patient, est-ce aussi une question culturelle ?
Martin Winckler : Le Canada est le seul pays développé au monde dans le quel il n’a pas de loi qui règlemente l’avortement. Jusqu’en 1988, il y avait dans le code criminel des dispositions qui disaient que l’avortement pouvait être permis sous certaines conditions, autrement les médecins pouvaient être poursuivis. Et un militant de l’avortement, Morgentaler, est allé devant la Cour Suprême du Canada, en disant que le problème, c’est que toute limitation de la liberté des femmes à avorter met leur sécurité en jeu. Parce que si vous n’avez que 12 semaines pour avorter et que vous devez avorter chez des médecins qui acceptent de le faire, et que vous habitez sur la baie James, et que vous êtes donc à 2000 km de Montréal, vous ne pouvez pas avorter dans de bonnes conditions. La Cour Suprême a décidé donc de casser les articles du code criminel qui réglemente l’avortement, et a demandé aux législateurs de faire une autre loi. Puis le législateur n’a jamais fait de loi, parce qu’ils ont bien vu que c’était trop compliqué, il n’y a pas de loi qui ne soit pas limitante. Mais la charte des droit et liberté dit : « Tout citoyen canadien a les mêmes droits et les mêmes prérogatives et les mêmes libertés, et son corps est inaliénable ». Par conséquent au Canada, une femme qui veut interrompre sa grossesse a parfaitement le droit de le faire et donc aucun médecin ne peut pas être poursuivi pour l’aider à exercer sa liberté. Et en théorie, une femme peut avorter jusqu’à sa 34eme semaine de grossesse, même si ça ne se fait jamais. Une femme avorte quand elle veut, c’est son corps, il n’y a pas à discuter. Le respect de l’individu est beaucoup plus propice aux soins. On ne peut pas soigner dans un rapport hiérarchique, quand il a du pouvoir il n’y a pas de soin.
Le respect de l’individu est beaucoup plus propice aux soins. On ne peut pas soigner dans un rapport hiérarchique, quand il a du pouvoir il n’y a pas de soin
#hopitaldufutur : Redonner du sens aux métiers du soin, c’est une nécessité ?
Martin Winckler : On ne soigne plus comme il y a 50 ans parce que nos rapports sociaux ne sont pas les mêmes, nos aspirations ne sont pas les mêmes. Le niveau d’exigence moral de la population s’élève, on ne tolère plus des choses qu’on tolérerait. Et surtout, le niveau d’exigence de la population s’élève, sur la gratification de leur travail. Quand vous soignez, la première gratification que vous avez, ce n’est pas le chèque à la fin du mois, c’est un patient qui va venir vous voir et qui vous dis que ce que vous lui avez donné a fonctionné, ou que depuis qu’il vous a vu, il se sent mieux. Nous sommes des êtres émotionnels, nous avons besoin d’être gratifié émotionnellement, ce n’est pas possible de fonctionner autrement. Si on n’est pas émotionnellement satisfait de ce qu’on a fait, on fait un burn-out et on n’a plus envie d’y bosser. C’est pour ça que la structure de l’hôpital en tant qu’usine à délivrer des soins compartimentés règlementés et calibrés pour pas couter trop cher, c’est un non-sens économique et humain.
Nous sommes des êtres émotionnels, nous avons besoin d’être gratifié émotionnellement, ce n’est pas possible de fonctionner autrement. Si on n’est pas émotionnellement satisfait de ce qu’on a fait, on fait un burn-out et on n’a plus envie d’y bosser. C’est pour ça que la structure de l’hôpital en tant qu’usine à délivrer des soins compartimentés règlementés et calibrés pour pas couter trop cher, c’est un non-sens économique et humain
#hopitaldufutur : Comment favoriser les interactions au sein de la communauté médicale ?
Martin Winckler : Encore faut-il définir ce qu’est la communauté médicale. C’est-à-dire que si la communauté médicale, ce sont juste les médecins entre eux, à la rigueur avec les infirmières, c’est insuffisant. Tout le monde a son mot à dire, et il y a plein d’informations qui viennent de gens qui ne sont pas médecins. Ce serait bien qu’il y ait des lieux dans lesquels les professionnels de santé, les soignants, discutent du fonctionnement du service sans forcément que les personnes soignées soient présentes. On ne va pas leur demander d’assister a des réunions dans les quels ils vont s’ennuyer plus qu’autre chose. Mais je pense qu’il faut aussi se poser la question de savoir, quand on prend des décisions, qu’on décide de fonctionner, est-ce qu’on n’est pas censé aussi aller leur présenter ce qu’on a pris comme décision, de façon qu’ils puissent donner leur avis ? L’un des problèmes, c’est que l’information, la discussion, le débat ne circule pas. Par exemple, dans la série Urgences, les scénaristes étaient médecins, mais allaient demander à des urgentistes de leur raconter les histoires les plus insolites qui leur arrivaient… C’est devenu la série médicale la plus réaliste qu’on ait jamais faite. Les histoires, ils les faisaient venir de partout, c’était une forme de partage. Il n’y a donc pas d’information qui ne soit pas intéressante à partager, les informations sont faites pour être partagées.
#hopitaldufutur : L’écoute, est-ce aussi un levier d’efficacité ?
Martin Winckler : La grande figure tutélaire de la médecine anglo-saxonne, c’est un monsieur qui s’appelle William Osler, Canadien, qui a enseigné au Canada, en Angleterre et aux Etats-Unis. En 1912, il disait : « Ecoutez bien ce que la personne qui entre dans votre cabinet vous dit, elle vous donne le diagnostic ». Dans le système français, les médecins dépensent des quantités colossales dans des examens complémentaires, parce que les médecins ne sont pas formés à écouter ce que les gens disent. Ils sont habitués à apprendre des symptômes, et il faut absolument regarder comment sont faites les questions d’internat, il faut que ça rentre dans les cases. Si ça rentre dans les cases, il a un diagnostic et très bien, et si ça ne rentre pas dans les cases, eh bien soit il n’a rien, soit c’est un simulateur, soit il ment. On ne peut pas soigner les gens comme ça ! C’est l’écoute de la personne qui va vous dire de quoi il souffre, ce qu’il veut, ce qu’il ne veut pas, de quoi il a peur, et tout ça fait partie du diagnostic. Avoir un hôpital décentralisé n’est pas du tout quelque chose qui va être défavorable à l’efficacité, au contraire, ce sera beaucoup efficace de faire la différence entre les gens qui ont un problème grave qui nécessite une hospitalisation, et les gens qui peuvent être soignés sur place.
#hopitaldufutur : Martin Winckler, le mot de la fin ?
Martin Winckler : En France, la structure est tellement hiérarchisée, peu importe qui est le roi au sommet, ça fonctionne toujours de la même manière. Si on devait redéfinir les choses, ce seraient les besoins des personnes qui devraient définir la structure. Mais c’est compliqué dans la réalité… C’est plus facile dans un roman !!!
Si on devait redéfinir les choses, ce seraient les besoins des personnes qui devraient définir la structure. Mais c’est compliqué dans la réalité... C’est plus facile dans un roman !!!